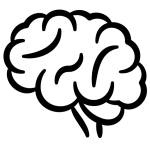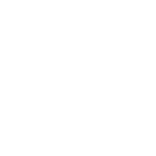Ce qui nous guide
Nos repères pour penser et agir autrement.
Dans cet espace, on rassemble les cadres de référence qui inspirent notre approche : une vision critique de la santé mentale, les fondements de l’action communautaire autonome, les déterminants sociaux de la santé, et le rôle central des savoirs issus du vécu. Des outils pour mieux comprendre ce qui structure nos actions et nous aide à garder le cap — même à contre-courant.
Des repères pour comprendre notre vision de la santé mentale et les fondements qui orientent nos actions.
Notre approche s’inscrit dans les principes de l’Action communautaire autonome (ACA). Elle prend racine dans l’entraide, la reconnaissance de l’expérience vécue, l’accompagnement égalitaire, le rôle des pair·e-entraidant·e et notre engagement dans la défense des droits.

Mémoire - Regard critique sur l’accueil de la santé mentale au Québec
Résumé du mémoire - Regard critique sur l’accueil de la santé mentale au Québec.
Notre pratique citoyenne en action
Une fiche pour comprendre comment nos valeurs prennent vie au quotidien, dans une approche ancrée dans l’écoute, la part...
Nos principes directeurs
Des repères pour comprendre ce qui oriente nos actions.Chaque principe incarne une posture : celle d’un accueil sans éti...
Groupes d'entraide et pairs aidants : des pratiques ancrées dans l’expérience
L'alternative en santé mentale par le RRASMQ
Produit par le RRASMQ, ce document explore les fondements de l’approche alternative en santé mentale. Il retrace son his...
L'ACA en 8 critères avec le RIOCM
Ce document présente les huit critères qui définissent l’Action Communautaire Autonome (ACA) selon le RIOCM. Il explique...
Cadre de référence en matière d'action communautaire
Le cadre de référence : une orientation issue de la politique gouvernementale sur l’action communautaire.
Des lectures qui font écho à notre démarche. Pour s’inspirer, se questionner, et porter un regard plus large.
Un pouvoir fou
La contribution du mouvement communautaire à l’avancement des droits en santé mentale.
Vison globale santé mentale & Itinérance - RAPSIM
Santé mentale & Itinérance - Adopter une vision globale
Recueil : L'approche globale - Contexte et enjeux
Projet de rédaction d'un document sur l'état de la situation quant à l'utilisation de l'approche globale dans le mouveme...
Effets de l’accompagnement - défense des droits en santé mentale
Les effets de l’aide et de l’accompagnement en promotion et ...
Cette section vise à redonner du sens à des termes qu’on utilise dans notre travail — des mots qui sont parfois galvaudés, mal compris, ou récupérés par des approches qui ne leur donnent pas la même portée que nous. L’idée ici n’est pas de faire un dictionnaire technique, mais plutôt de partager notre compréhension de ces mots, avec du vécu, du contexte, et du sens.
Souvent vue comme une recherche personnelle ou existentielle, individuelle et intérieure.
Pour nous, c’est bien plus que ça.
La quête de sens est une manière de traverser ce qu’on vit, de chercher à comprendre — non pas ce qui “cloche” en nous, mais ce que nos expériences disent de notre monde.
C’est reconnaître que nos malaises ne viennent pas de nulle part. Ils prennent racine dans des contextes sociaux, culturels, politiques.
Chercher du sens, c’est donc interroger ces contextes, et ne pas se contenter d’une explication médicale ou d’un diagnostic.
C’est une démarche vivante, souvent inconfortable, mais profondément humaine — qui ne cherche pas à “guérir” un soi défaillant, mais à reprendre du pouvoir sur sa vie.
Souvent réduite à l’idée de faire des choix ou de gagner en autonomie personnelle.
Pour nous, c’est bien plus large.
Reprendre du pouvoir sur sa vie, ce n’est pas juste “aller mieux” ou “devenir fonctionnel”.
C’est reprendre une place active dans sa propre histoire, malgré ce qu’on a vécu ou ce qu’on nous a fait croire.
C’est refuser d’être seulement un·e bénéficiaire, un·e patient·e, un “cas” à prendre en charge.
C’est retrouver du contrôle, mais aussi du sens, du lien, des possibilités d’action.
Et ce pouvoir ne se résume pas à une volonté individuelle. Il est influencé par nos conditions de vie, par les ressources accessibles (ou non), par les structures sociales.
C’est pourquoi la reprise du pouvoir est aussi un enjeu collectif.
Elle se construit dans des espaces où on peut être entendu·e, reconnu·e, respecté·e — pas jugé·e, corrigé·e ou normalisé·e.
Souvent perçu comme une vérité sur une personne, une étiquette qui définit « ce qu’elle a ».
Pour nous, un diagnostic n’est pas une identité.
C’est un outil clinique, utilisé par des professionnel·le·s pour organiser, nommer et encadrer des comportements ou des états de détresse.
Mais trop souvent, il devient un point final à une histoire complexe. Une étiquette qui colle à la peau, qui fige une personne dans un rôle, un trouble, une case.
On oublie alors tout ce qui entoure ce diagnostic : les conditions sociales, les injustices, les pertes, les pressions, les liens brisés. On oublie aussi que les classifications changent avec le temps, les cultures, les contextes. Rien n’est figé.
Refuser de s’en tenir au diagnostic, ce n’est pas nier la souffrance.
C’est refuser de réduire une personne à ce qu’on a noté dans un dossier.
C’est redonner la parole à celles et ceux qui vivent les choses de l’intérieur — et qui ont souvent bien plus à dire que trois lettres et un chiffre.
Souvent confondu avec jugement ou négativité.
Pour nous, avoir un regard critique, c’est poser des questions là où on attend des réponses toutes faites.
C’est ne pas prendre pour acquis ce qu’on nous présente comme “normal”, “scientifique” ou “inévitable”.
C’est se demander :
– Qui a défini cette norme?
– Qui en bénéficie?
– Qui en souffre?
Un regard critique, ce n’est pas une posture contre tout.
C’est une posture de vigilance, une capacité à interroger les systèmes, à écouter les vécus invisibles, à nommer les angles morts.
Dans le domaine de la santé mentale, c’est refuser de croire que les réponses se trouvent uniquement dans les diagnostics, les médicaments ou les suivis.
C’est ouvrir la discussion sur les causes sociales, sur les alternatives, sur le droit à vivre autrement.
Souvent vue comme “aider les autres”, faire preuve de bonté ou de charité.
Pour nous, l’entraide, c’est tout sauf un geste unilatéral.
C’est un rapport égalitaire : on donne, mais on reçoit aussi.
C’est une manière de vivre ensemble, de créer du lien à partir de ce qu’on traverse, de nos expériences, de nos forces.
Loin d’être une solution de dernier recours, l’entraide est une force collective, un levier pour résister à l’isolement, à l’impuissance, au découragement.
Ce n’est pas l’affaire des “aidants” d’un côté et des “aidé·es” de l’autre.
C’est un espace où chacun·e a quelque chose à partager.
Dans un monde qui pousse à la performance et à l’individualisme, l’entraide, c’est une façon d’aller à contre-courant.
De se rappeler qu’on avance mieux ensemble — pas parce qu’on est “brisés”, mais parce qu’on est humains.
On a souvent réduit le rôle du·de la pair·e à celui d’un·e ancien·ne “usager·ère” qu’on recycle en intervenant·e. Une personne supposément “rétablie” qui montrerait le bon chemin.
Mais ce n’est pas notre vision.
Un·e pair·e-entraidant·e, c’est quelqu’un·e qui a traversé des tempêtes. Qui a connu l’incompréhension, la marginalisation, les détours. Et qui choisit de mettre son vécu au soutien des autres , pas pour dicter quoi faire, mais pour être là, avec.
Son savoir n’est pas un bonus à un diplôme. C’est une connaissance issue de l’expérience, brute, humaine, lucide. Un savoir qui donne accès à une parole vraie, souvent la seule capable d’ouvrir un espace de confiance pour celles et ceux que les approches traditionnelles laissent de côté.
Être pair·e-entraidant·e, ce n’est pas avoir “réussi”.
C’est continuer à avancer, avec les autres.
Porter ses doutes, ses forces et aussi ses limites.
C’est croire que nos vécus, lorsqu’ils se rencontrent, peuvent créer du sens et faire émerger autre chose.
Souvent mis de côté ou vu comme moins “valable” qu’un savoir scientifique ou professionnel.
Pour nous, le savoir expérientiel, c’est ce qu’on a appris en vivant les choses.
C’est ce qu’on sait parce qu’on l’a traversé — pas parce qu’on l’a lu, étudié ou observé de l’extérieur.
Ce savoir-là naît de la douleur, du doute, de la résistance, de l’adaptation.
Il prend racine dans l’expérience humaine, dans la réalité vécue, avec tout ce qu’elle a de complexe, de nuancé, de parfois invisible pour les autres.
Reconnaître les savoirs expérientiels, c’est refuser que seules les “expert·es” aient le droit de nommer, d’interpréter, d’expliquer.
C’est dire que la personne qui vit quelque chose en sait souvent plus sur ce vécu que celle qui l’analyse de loin.
Ces savoirs ne sont pas accessoires : ils sont essentiels pour repenser les pratiques, pour construire des solutions qui ont du sens, pour redonner une voix à celles et ceux qu’on a trop souvent fait taire.
Une approche souvent méconnue ou réduite à “des organismes qui aident”.
L’ACA, c’est bien plus que de l’aide.
C’est une façon d’agir qui part des besoins, des réalités et des savoirs des personnes concernées.
Les groupes en ACA ne sont pas là pour “faire à la place de”, mais pour créer des espaces où les gens peuvent se mobiliser, se soutenir et reprendre du pouvoir sur leur vie.
Concrètement, ça veut dire :
– Des actions pensées par et pour la communauté
– Une autonomie réelle face aux institutions
– Des valeurs d’égalité, de justice sociale et de transformation collective
L’ACA refuse les solutions toutes faites. Elle mise sur la participation, l’éducation populaire, la solidarité, et surtout, sur la conviction que les personnes ont la capacité de comprendre, de décider et d’agir.
C’est une pratique politique, au sens noble du terme : agir ensemble pour transformer ce qui ne fonctionne pas.
L’éducation populaire est une démarche d’apprentissage collective et critique, qui vise à outiller les personnes pour comprendre et transformer leur réalité. Elle peut être portée par des organismes communautaires, des syndicats, des institutions publiques ou des groupes citoyens.
Caractéristiques principales :
- Vise l’émancipation individuelle et collective
- S’appuie sur les savoirs d’expérience et les savoirs académiques
- Peut être financée ou soutenue par l’État
- Se déroule parfois dans des cadres institutionnels (centres communautaires, cégeps, etc.)
- Encourage la participation citoyenne et le développement du pouvoir d’agir
Cette section rassemble des plans officiels en santé mentale, en lutte contre la pauvreté et d’autres enjeux sociaux, accompagnés d’analyses proposées par divers mouvements. L’objectif : mieux comprendre les orientations actuelles, les mettre en perspective et ouvrir la réflexion sur d’autres possibles.
Plan d’action interministériel en santé mentale 2022-2026
Plan 2022-2026
Le rendez-vous manqué - Plan d'action santé mentale analyse
Analyse réalisée par AGIDD-SMQ
Lettre à mon ministre de la santé : Ô capitaine, mon capitaine !
Benoît Côté, directeur général Pech 11 avril 2023
Analyse du COSME - PAISM 2022-2026
Les éléments positifs, les bons coups et les déceptions du PAISM
Plan d’action gouvernemental - lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 2024-2029.
Se donner les moyens d’éliminer la pauvreté
Mémoire déposé dans le cadre de la consultation publique pour le quatrième plan d’action gouvernemental en matière de lu...
Tu veux faire vivre une autre vision de la santé mentale ailleurs ?
Voici des ressources à télécharger pour informer, questionner et inspirer, que ce soit dans un local, une salle d’attente, une formation ou une activité communautaire.
On y trouve des outils créés par notre équipe et d’autres ressources inspirantes provenant de partenaires qui partagent une vision critique et humaine de la santé mentale.
Des supports concrets pour nourrir la réflexion et ouvrir le dialogue, partout où c’est nécessaire.

Un outil visuel pour sortir des idées préconçues, nommer les vrais enjeux et ouvrir la discussion, que ce soit en groupe ou en solo.

La santé mentale, un enjeu collectif! Le PCEIM s'est associé avec l'illustrateur @martinpm.bd pour mettre en lumière son approche différente via une superbe BD !
Pour aller plus loin. Des sites et ressources pour continuer la réflexion.
Le RRASMQ
Un regroupement d’organismes communautaires qui défendent une approche alternative en santé mentale, centrée sur l’affirmation, l’innovation sociale et une vision différente des expériences vécues.
L’AGIDD-SMQ
Un acteur engagé pour la défense des droits des personnes ayant vécu un problème de santé mentale, qui porte un regard critique sur les pratiques en santé mentale et lutte contre les préjugés, en valorisant le point de vue des premiers concernés.
Le RQ-ACA est l’interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d’action communautaire autonome. Grâce à son expertise et à celle de ses membres, il porte et amplifie la voix du mouvement de l’action communautaire autonome afin de défendre ses valeurs et ses pratiques et de faire advenir une société plus juste et équitable.
Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie.
La TROC-Montérégie regroupe près de 300 organismes communautaires autonomes oeuvrant en santé et services sociaux sur le territoire de la Montérégie. Ils sont impliqués dans de nombreux secteurs d’intervention auprès des citoyennes et des citoyens de notre région.
La Corporation de développement communautaire (CDC) Roussillon est un regroupement multisectoriel d’organismes communautaires de la Rive-sud de Montréal.
Elle œuvre dans divers champs d’activité sur un territoire donné, dont la mission est d’assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socioéconomique de son milieu.
Corporation de développement communautaire Jardins-de-Napierville
La CDC est un regroupement de près de 30 organismes communautaires œuvrant dans divers champs d’activités. Son but est de favoriser la concertation relative aux enjeux sociaux afin de contribuer, dans une perspective de responsabilité partagée, à une transformation sociale pour mieux desservir la population des Jardins-de-Napierville.